J’ai beau savoir que je vais découvrir de nouveaux livres d’ici la fin de 2017, il y en a un, parmi tous ceux que j’ai lus depuis le premier janvier, qui me reste en mémoire. Et je sais déjà, peu importe ce que je vais lire dans les trois prochains mois, que c’est lui qui me restera en tête comme ma lecture la plus marquante de l’année. Voire une des lectures les plus marquantes de ma vie, tout court.
Aujourd’hui, j’avais envie d’écrire sur les claques littéraires, ou plus précisément les livres qui changent votre vie et (ou) votre vision du monde. J’ai déjà parlé de quelques lectures qui ont été déterminantes pour moi dans mon article sur les chocs esthétiques. Des livres qui, au même titre que des albums ou des films, ont contribué à forger mon style d’écriture, mon univers et plus globalement ce que je suis. Ceux dont je veux parler ici sont aussi importants, mais suivent une logique légèrement différente. Il ne s’agit pas de livres que je pourrais mettre dans un portrait chinois, si jamais on me demandait « Si tu étais un livre… ». Ce sont des livres qui, une fois refermés, m’ont fait voir le monde différemment, sans retour en arrière possible. On parle parfois de romans qui ont « changé la vie » des gens. Je ne sais pas si ceux dont je vais parler obéissent à cette règle, mais ce qui est certain, c’est que je ne m’en suis pas remise.
Il y en aura certainement d’autres au cours de ma vie, mais à vingt-six ans, ces livres sont deux : A rebours de Joris-Karl Huysmans, et Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski.
J’ai découvert A rebours pendant ma glorieuse troisième année de licence. C’est une période dont je me souviens toujours avec beaucoup de plaisir, parce qu’elle est digne d’un véritable roman. En suivant des études de Lettres et Théâtre, en baignant dans la littérature romantique à longueur de journée et en me pavanant en chemise/veste/chapeau, tomber sur Huysmans était difficilement évitable. A l’époque, j’écoutais énormément de musique anglaise. Parmi les dieux du foyer de Narcissus Castle (ainsi avions-nous baptisé notre appartement étudiant avec ma coloc), nous avions le duo de musiciens Carl Barât et Peter Doherty. Écouter les Libertines aujourd’hui nous ramène immanquablement à cette période – sans nostalgie, pour ma part, parce que j’estime que c’est un frein et une perte de temps. Nous connaissions leur œuvre par cœur et ces messieurs nous ont, sans le savoir, fait élargir nos horizons littéraires. Que ça soit quand ils composent ensemble (au sein des Libertines), en solo ou dans leurs groupes respectifs, Carl Barât et Peter Doherty adorent les références. C’est ainsi que j’ai découvert la chanson A rebours, des Babyshambles (le groupe de Doherty), qui piquait son titre à un roman français décadent du XIXème siècle. Il n’en fallait pas plus pour me tenter – si ce n’est apprendre qu’Oscar Wilde avait lui aussi admiré l’ouvrage. Je l’ai emprunté, et je n’oublierai jamais les circonstances dans lesquelles je l’ai lu. Pendant un week-end, ma famille a décidé de passer le week-end dans un grand hôtel à la frontière espagnole. C’est dans le sous-sol de cet hôtel luxueux, installée dans un grand fauteuil en cuir, que j’ai dévoré A rebours. Je ne suis jamais retournée dans un tel lieu et j’ignore si ça arrivera, mais le souvenir de cette lecture est gravé dans mon esprit, indissociable du livre lui-même.
A rebours, c’est l’histoire de Des Esseintes, un jeune homme lassé du monde qui décide de se retirer dans une maison, loin de la ville. Là, il esthétise son existence à l’extrême. Livres raffinés et dangereux, reproductions de tableaux, parfums, fleurs vénéneuses et expériences étranges : Des Esseintes crée autour de lui un monde où règne la beauté et s’isole à l’intérieur. La fin n’est pas vraiment un spoiler en soit (est-ce vraiment une fin ?), alors la voici en une phrase. Des Esseintes finit par se rendre compte que son style de vie commence à le tuer et, déçu, décide de revenir à la civilisation.
C’est un postulat très simple, et presque une non-intrigue. A rebours peut rebuter plus d’un lecteur à cause de son côté « catalogue ». Pendant de longs chapitres, Huysmans décrit les collections de Des Esseintes, le tout à travers les yeux de son héros. Le roman a apparemment cartonné auprès des jeunes artistes à sa publication, en 1884, et semble toujours avoir le même effet plus d’un siècle plus tard. (Récemment, j’ai vu une interview d’Umberto Ecco qui exhibait fièrement sa première édition d’A rebours : il l’avait adoré à vingt ans et souhaitait en avoir une copie.)
J’ai lu A rebours une fois, et j’ignore si je le relirai un jour. Mais je me souviens de l’impression qu’il a produit sur moi, et de ce que j’ai ressenti en le refermant. Je savais que quelque chose avait changé, et je n’ai plus vu le monde tout à fait de la même façon. Peut-être avais-je perdu deux ou trois illusions au cours de ma lecture. A rebours est un livre peu accessible, qu’il faut ouvrir avec prudence…
A l’inverse, Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski a été une lecture dont je peux dire avec exactitude pourquoi elle m’a marquée. (Ce qui suit ne comporte pas de spoilers.) Je l’ai lu pendant la première moitié de cette année, en avril ou en mai. D’abord, petite remise en contexte. La première fois que j’ai eu vent de ce pavé de 975 pages, je cherchais des infos sur la sortie (sans arrêt repoussée) du tome 4 des Salauds Gentilshommes. Je suis tombée sur cette excellente critique de Gagner la guerre qui faisait des parallèles entre les univers des deux romans. La chronique s’ouvrait comme suit : « Je suis un gros connard prétentieux qui pense que les bons livres de Fantasy se comptent sur les doigts de la main. Je suis même un gros connard prétentieux qui pense que la littérature française est une fange au passé simple qui a oublié ses glorieuses heures pour se bâfrer dans les immondices de l’autofiction sans imagination ». Je l’admets, je ne suis pas loin de partager cet avis, l’auteur de l’article avait donc toute mon attention. Il a réussi à me convaincre d’acheter Gagner la guerre, et c’était la première fois que je lisais un aussi gros pavé d’un coup depuis David Copperfield de Dickens. (Donc, sacrément longtemps. Presque dix ans, en fait.)

Et hop on saute ! Rien que de me souvenir du passage illustré par cette couverture me donne envie de vanter ce livre grandiose.
D’une part, ça m’a réconciliée avec les pavés, auxquels je me suis remise depuis. De l’autre, ça m’a fait vendre ce bouquin à la Terre entière une fois sortie de ma lecture. Je ne sais pas ce que je lirai d’ici la fin de l’année – même si j’ai beaucoup d’envies et une liste de lecture longue comme le bras. Mais je sais que Gagner la guerre est ma claque de 2017, et qu’elle a eu un effet positif sur moi. Pourtant, ça peut paraître paradoxal, puisque son personnage principal, Don Benvenuto, est un anti-héros notoire. Pour la faire courte, Gagner la guerre, c’est…
Une histoire qui prend place à Ciudalia, l’équivalent de Venise période Renaissance dans un monde de Fantasy. La ville vient de gagner la guerre, et elle doit assurer sa position. Comprendre : être le théâtre de quelques coups tordus, et opérer le nettoyage de rivaux potentiels. Don Benvenuto est le meilleur tueur à gages du royaume, et il sera votre guide (peu recommandable) dans cette folle équipée.
J’aimais déjà l’idée, mais je crois que ça a été le coup de foudre dès les premières pages. On vante beaucoup la plume de Jaworski, à juste titre. Don Benvenuto étant le narrateur, son cynisme, son argot et sa flamboyance traversent toute l’œuvre. On le quitte jamais, et Jaworski arrive à nous faire ressentir tout ce que son héros traverse : quand il est blessé, qu’il souffre physiquement, on souffre avec lui. Mais c’est aussi piégeux, puisque Benvenuto est un anti-héros… et que le lecteur l’accompagne aussi quand il commet le pire. Même celui qu’on ne peut pas approuver, et qu’on ne veut surtout pas voir. A tel point que j’ai dû reposer le livre à un moment précis de l’intrigue, pour entrer dans un dilemme d’une demi-heure : est-ce que je peux continuer à m’attacher à un héros qui vient de commettre une atrocité pareille ?
Mais j’étais dedans, j’étais fascinée par l’univers et le héros, je suis donc allée au bout de ma lecture. J’ai lu Gagner la guerre en deux semaines et demi – et j’ai rattrapé mon retard en lecture hebdomadaire en lisant trois bouquins la semaine suivante. Je suis ressortie du roman, de cette immersion totale, avec une question : et maintenant ? Soit la marque d’un grand livre. Quitter un tel univers et devoir reprendre le cours de ma vie comme si de rien n’était… était impossible. Parce que, aussi répréhensibles soient les actions de Benvenuto, j’avais passé plus de quinze jours en sa compagnie. Et Dieu sait qu’en 975 pages, on avait vécu de sacrés trucs.
Je crois que la meilleure chose que je puisse dire sur Gagner la guerre et l’effet qu’il a eu sur moi, c’est que j’en suis ressortie grandie.
C’est un livre qui m’a rendue plus courageuse, plus sûre de moi et plus déterminée. Chose amusante, je l’ai lu en pleine période des présidentielles, et ça m’a permis de mieux comprendre et analyser ce qui se passait. Car Gagner la guerre est fortement influencé par Machiavel, et les stratégies politiques de certains personnages sont brillamment décrites. La stratégie, parlons-en : c’est une capacité que j’ai dû – par la force des choses – apprendre à développer, et je pense que ce roman n’y est pas pour rien.
Quand je vante Gagner la guerre, je préviens certaines personnes : le livre est dense et exigeant, et Don Benvenuto est tout sauf un modèle à suivre. (Sauf au niveau de la capacité de survie et des aptitudes de duelliste, peut-être.) Mais le voyage vaut le détour. J’avais prévu de lire des livres qui font voyager cette année, de grandes aventures, et celle-ci est assurément la plus marquante.
Irez-vous à la rencontre de Des Esseintes et Don Benvenuto ? Le choix vous revient.











 é le Joker à Loki. Pas à celui des films, à celui de la mythologie nordique – même si celui des films Marvel lui reste assez fidèle. La comparaison est juste : Loki est par excellence le dieu de la ruse, de la plaisanterie et, d’une certaine manière, un agent du chaos. (Pour plus d’information sur le God of Mischief, je vous renvoie à
é le Joker à Loki. Pas à celui des films, à celui de la mythologie nordique – même si celui des films Marvel lui reste assez fidèle. La comparaison est juste : Loki est par excellence le dieu de la ruse, de la plaisanterie et, d’une certaine manière, un agent du chaos. (Pour plus d’information sur le God of Mischief, je vous renvoie à  Une autre analyse
Une autre analyse 

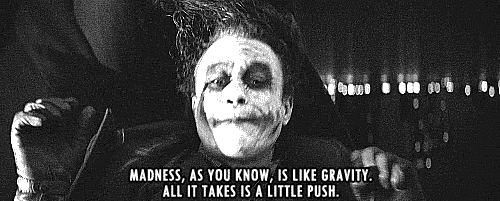
 bien. Ce qu’il veut défaire, c’est l’héroïsme de Batman, l’idéalisme du procureur incorruptible Harvey Dent. Moins pour en tirer un profit personnel que pour remodeler le monde selon l’idée qu’il s’en fait : un charnier où tout est voué à pourrir. D’une vision démiurgique à l’autre, le Joker s’est défait de sa bouffonnerie pop pour devenir une figure tragique, dangereusement romantique même. »
bien. Ce qu’il veut défaire, c’est l’héroïsme de Batman, l’idéalisme du procureur incorruptible Harvey Dent. Moins pour en tirer un profit personnel que pour remodeler le monde selon l’idée qu’il s’en fait : un charnier où tout est voué à pourrir. D’une vision démiurgique à l’autre, le Joker s’est défait de sa bouffonnerie pop pour devenir une figure tragique, dangereusement romantique même. »





 dieu de la ruse, et je me suis rendue compte que les réalisateurs avaient fait un sacré bon boulot : le personnage incarné par Tom Hiddleston ne trahit absolument pas l’image que j’ai eu de Loki en lisant divers récit légendaires. Si vous êtes curieux, j’ai récemment lu Odd et les Géants de Glace, un récit pour enfants signé Neil Gaiman paru en 2009. Loki, Thor et Odin figurent parmi les personnages principaux. Le livre peut être lu à tous âges et respecte la mythologie nordique. Le personnage de Loki est fidèle à lui-même : si vous l’avez aimé dans les films Marvel, vous l’aimerez dans ce petit bouquin – délicieusement illustré par Brett Helquist.
dieu de la ruse, et je me suis rendue compte que les réalisateurs avaient fait un sacré bon boulot : le personnage incarné par Tom Hiddleston ne trahit absolument pas l’image que j’ai eu de Loki en lisant divers récit légendaires. Si vous êtes curieux, j’ai récemment lu Odd et les Géants de Glace, un récit pour enfants signé Neil Gaiman paru en 2009. Loki, Thor et Odin figurent parmi les personnages principaux. Le livre peut être lu à tous âges et respecte la mythologie nordique. Le personnage de Loki est fidèle à lui-même : si vous l’avez aimé dans les films Marvel, vous l’aimerez dans ce petit bouquin – délicieusement illustré par Brett Helquist.
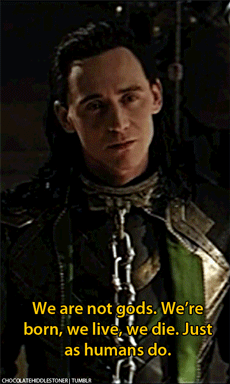

 Avengers – et voilà. Rédemption obtenue. Sauf que… Eh oui, la fin du film. Donc, à la fin du film, le spectateur découvre que Loki a survécu et pris la place d’Odin sur le trône d’Asgard. Sous l’apparence de ce dernier (j’étais ravie que le pouvoir de transformation de Loki, très présent dans la mythologie nordique, soit montré dans le film), il laisse Thor renoncer à hériter du trône et retourner sur Terre pour vivre d’amour et d’eau fraîche avec Jane. Et voilà, tout est bien qui finit bien, d’un côté comme de l’autre. JUSTEMENT. Loki n’est pas siiiii… eh ben, méchant que ça, en fin de compte.
Avengers – et voilà. Rédemption obtenue. Sauf que… Eh oui, la fin du film. Donc, à la fin du film, le spectateur découvre que Loki a survécu et pris la place d’Odin sur le trône d’Asgard. Sous l’apparence de ce dernier (j’étais ravie que le pouvoir de transformation de Loki, très présent dans la mythologie nordique, soit montré dans le film), il laisse Thor renoncer à hériter du trône et retourner sur Terre pour vivre d’amour et d’eau fraîche avec Jane. Et voilà, tout est bien qui finit bien, d’un côté comme de l’autre. JUSTEMENT. Loki n’est pas siiiii… eh ben, méchant que ça, en fin de compte.


 Philario, un ami de mon père que je ne connais que par correspondance ; c’est là que vous m’écrirez, ma reine, et mes yeux boiront chacun de vos mots, leur encre fût-elle du fiel. (…) Si nous prolongions nos adieux pendant toute la durée de notre vie, l’horreur n’en serait que plus grande ! Adieu !
Philario, un ami de mon père que je ne connais que par correspondance ; c’est là que vous m’écrirez, ma reine, et mes yeux boiront chacun de vos mots, leur encre fût-elle du fiel. (…) Si nous prolongions nos adieux pendant toute la durée de notre vie, l’horreur n’en serait que plus grande ! Adieu !




 Écouter Helen Kane me fait toujours sourire : ses chansons sont drôles, parfois touchantes et mettent de bonne humeur. Je vois souvent des gens déprimés dans les transports et je pense que non seulement ils ne prêtent pas attention à ce qu’il y a autour d’eux, mais aussi qu’ils n’écoutent pas la bonne musique. Helen Kane met du baume au cœur et réchauffe les pièces froides.
Écouter Helen Kane me fait toujours sourire : ses chansons sont drôles, parfois touchantes et mettent de bonne humeur. Je vois souvent des gens déprimés dans les transports et je pense que non seulement ils ne prêtent pas attention à ce qu’il y a autour d’eux, mais aussi qu’ils n’écoutent pas la bonne musique. Helen Kane met du baume au cœur et réchauffe les pièces froides.






